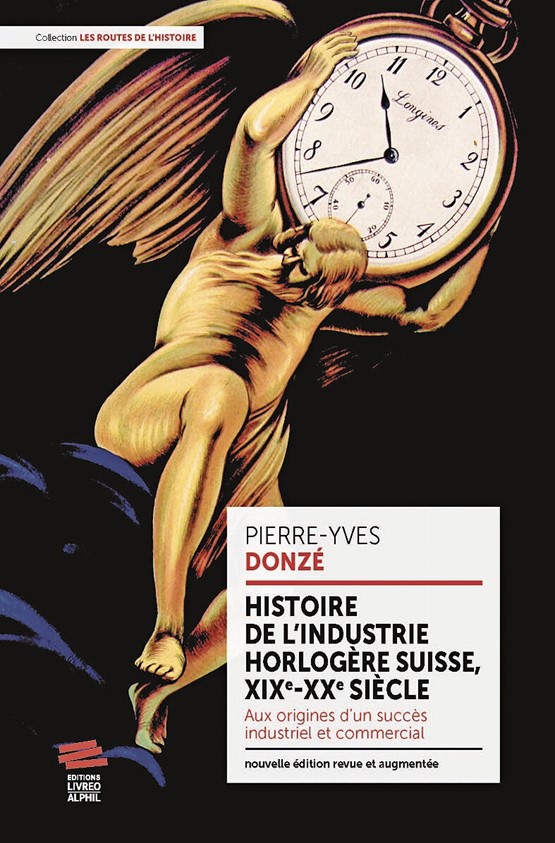JAM: Les derniers chiffres de la branche horlogère sont mauvais: en août déjà, les ventes de montres suisses à l’étranger reculaient de 16,5%. Et en décembre, on enregistrait un premier repli de l’emploi depuis la pandémie. Quel regard l’historien spécialisé que vous êtes porte-t-il sur ces chiffres inquiétants?
Pierre-Yves Donzé: La première chose à dire, c’est qu’une fois de plus, l’horlogerie fait face à une crise ou à un début de crise. Cela dit, en tant qu’historien, je ne suis pas surpris. Parce que, depuis qu’il existe des statistiques sur les exportations horlogères, donc depuis 1885, une année sur trois en moyenne a été une année de récession. Donc les crises et les récessions font partie de la vie de ce secteur.
En définitive, tout l’enjeu consiste à savoir à quel type de crise nous avons affaire.
«DANS L’HORLOGERIE, UNE ANNÉE SUR TROIS EN MOYENNE A ÉTÉ UNE ANNÉE DE RÉCESSION.»
Nous nous trouvons tout au début d’une petite récession. Mais s’agit-il d’une crise qui est simplement conjoncturelle, qui se résumerait pour un certain nombre de raisons à une baisse de la demande temporaire? Ou au contraire, cette crise serait plus grave et de nature structurelle? Auquel cas notre tâche serait de comprendre si cette récession est la résultante de l’émergence de nouveaux concurrents, ou de nouveaux comportements des consommateurs, donc de raisons qui mettent en cause plus fondamentalement le business model horloger.
Et à votre avis?
L’horlogerie a fait souvent face à ces deux types de crises dans le passé, c’est ce qui fait qu’il y a beaucoup d’incertitudes aujourd’hui. Nous avons ici clairement affaire à un début de récession, mais il est encore trop tôt pour donner une signification à ce phénomène, c’est très compliqué.
Et à plus long terme, sur la prochaine décennie?
Deux grands scénarios sont plausibles. Le premier est plus optimiste, voire naïf. Nous aurions une crise conjoncturelle et par la suite, nous pourrions assister à un redémarrage sur le marché chinois avec des niveaux comparables à ceux que nous avons connu avant la pandémie de Covid. Ou alors les ventes en Chine ne reprennent pas et un autre marché pourrait progressivement la remplacer: ce pourrait être l’Inde, le Moyen-Orient.
Et puis il y a le scénario plus grave, plus pessimiste: en fait nous aurions affaire à un nouveau comportement des consommateurs. Dans ce cas, pour la génération Z et les suivantes, la montre perdrait son importance, même comme accessoire de mode. Les consommateurs, mis à part quelques personnes très riches qui continueraient de consommer des biens exceptionnels exprimant leur position sociale particulière, n’auraient plus besoin d’avoir un objet au poignet, surtout une montre chère puisque tout le monde dispose d’un smartphone qui remplace tout. Dans ce scénario, Rolex, Audemars Piguet et Patek Philippe continueraient de très bien se porter.
Donc voilà les deux sentiments qui prévalent actuellement: un scénario pessimiste pour l’industrie et un autre plus optimiste pour quelques rares marques. Pour ma part, ces deux chemins sont en concurrence. Pour l’instant, personne ne peut dire lequel des deux finira par s’imposer.
«DANS LE PREMIER SCÉNARIO, PLUS OPTIMISTE, NOUS AURIONS UNE CRISE CONJONCTURELLE.»
Cette récession pourrait-elle sonner le glas du luxe accessible qui s’était développé au cours des dernières décennies, comme vous le décrivez dans vos ouvrages, au détriment du luxe exclusif?
Actuellement, toute l’attention se porte sur le luxe exclusif et les marques horlogères qui exportent le plus sont positionnées sur ce segment. Pourquoi? C’est ça la question. Dans les facteurs à analyser, il y a l’inflation globale post-Covid qui touche les classes moyennes et les classes moyennes supérieures. On voit ces dernières s’éloigner de la consommation de biens à valeur très tangible et repositionner leurs achats sur des biens qui conservent de la valeur, comme l’or, dont le cours explose. On préfère acheter de l’or et attendre que la crise inflationniste passe.
«LE SECOND SCÉNARIO est PLUS GRAVE: LA MONTRE PERDRAIT SON IMPORTANCE.»
C’est particulièrement le cas en Chine. Dans ces circonstances de perte de valeur due à l’inflation globale, le consommateur tend à se tourner vers des produits à haute valeur ajoutée comme l’or et le franc suisse. Mais que se passera-t-il par la suite, lorsque la crise inflationniste sera passée: les consommateurs reviendront-ils aux montres de luxe accessibles? C’est une autre question qui pour l’heure reste sans réponse.
Dans votre livre très documenté sur Rolex, publié chez Alphil, vous décrivez ce moment particulier perçu comme la fin de l’histoire horlogère, avec une marque globale parfaite qui n’évolue presque plus. À quelle suite faut-il s’attendre pour ce leader incontesté de la branche?
En fait, cette histoire ne se termine jamais. Ce qu’on voit sous le régime de Jean-Frédéric Dufour, depuis dix ans, c’est que la stratégie du luxe s’est de plus en plus affinée. Les différents CEO qui se sont succédés n’ont pas touché le cœur de la stratégie Rolex. Cela donne l’impression que cette dernière ne change jamais. Ce que les CEO transforment, je dirais, c’est l’environnement, l’infrastructure du business de Rolex. Avant Dufour, et pendant longtemps, les efforts ont porté essentiellement sur la verticalisation de la production.
Et puis pour la période actuelle, je dirais que deux choses semblent se dessiner. D’une part la verticalisation de la distribution et du retail, comme le montre le rachat de Bucherer, la volonté d’ouvrir des boutiques de cette marque dans de nombreuses villes à l’international. La question est disputée, mais on voit quand même se dessiner une stratégie dans laquelle le retail devient de plus en plus important. Et puis, deuxièmement, une stratégie de luxe beaucoup plus affirmée avec un renouvellement des collections qui, du moins en apparence, ne semblent pas être renouvelées.
C’est un paradoxe?
Oui, le fait est qu’on ne change pas basiquement les modèles de Rolex, mais on en transforme le design en des modèles plus colorés, des modèles qui s’adressent précisément à une nouvelle génération de consommateurs pour lesquels la tradition est moins importante que le fun et le design. Donc Rolex parvient très bien à jouer aussi sur cette dimension. Ce qui démontre que son histoire n’est jamais terminée.
Quel équilibrisme! Car pour avoir une marque globale, expliquez-vous, Rolex, comme Audemars Piguet, ont limité le nombre de modèles en évitant de les adapter à des marchés particuliers. Mais en même temps, elles sentent le besoin de s’adapter à de nouveaux consommateurs?
Oui, exactement. En théorie, une marque globale n’adapte jamais rien à des marchés particuliers. Et puis dans la pratique, on se dit que quand même, pour un marché spécial, on va procéder à des aménagements. Une adaptation semble donc possible dans certains cas.
Dans votre livre sur Swatch Group, aussi chez Alphil, vous décrivez le déclin actuel. Le mythe est tellement puissant qu’on a de la peine à y croire. En même temps, les nouvelles sont mauvaises. Il y a aussi ce conflit avec un actionnaire dont on peine à décrypter les enjeux. Comment évaluez-vous la situation de ce géant qui en est à sa troisième génération?
Toutes ces mauvaises nouvelles sur l’emploi signalent le début d’une crise dont nous avons parlé et qui touche de plein fouet l’horlogerie moyen de gamme et l’horlogerie du luxe accessible, donc les entreprises qui travaillent avec d’importants volumes. Chez Swatch Group, l’emploi est beaucoup plus touché que dans le luxe exclusif qui emploie moins de collaborateurs, où les volumes sont moins importants. Quant à la caricature de la troisième génération qui casse tout, je dirais que Swatch Group exemplifie cette «loi» qui, du reste ne tient pas la route. C’est un cliché: je suis basé au Japon où certaines entreprises existent depuis quinze générations. Parfois en revanche, il suffit d’une seule génération pour connaitre l’insuccès.
Reste que l’histoire du Swatch Group semble exemplifier cette caricature: avec un fondateur génial, une deuxième génération qui arrive aux commandes et ne change rien, en poursuivant totalement sur la même lancée, alors que l’environnement a changé et qu’il faudrait s’adapter au déclin du luxe accessible et à l’essor du luxe exclusif.
On peut toujours se dire qu’on n’a pas envie de faire du luxe, mais si les consommateurs en veulent, cette attitude devient une erreur, celle que commet la deuxième génération chez Swatch Group. La troisième génération qui pointe à l’horizon semble être complètement déconnectée des réalités du luxe horloger. Le risque d’aggraver sa baisse de compétitivité est donc bien réel. À cause de cette attitude, Swatch Group est un groupe qui malheureusement connaît beaucoup de problèmes. S’agit-il d’une incapacité à voir les enjeux ou d’un désintérêt total pour l’industrie du luxe? Je ne saurais le dire, mais c’est dans tous les cas une tendance qui porte toute l’horlogerie mondiale aujourd’hui.
Chez LVMH, vous avez aussi commenté l’arrivée de Frédéric Arnault, fils de Bernard Arnault, et de ses déboires à la tête de Tag Heuer. On est loin de la génération Jean-Claude Biver et de ses managers inspirés, visionnaires?
Je suis moins négatif pour LVMH. Je crois que Bernard Arnault peut montrer une certaine froideur décisionnelle. Et ce qu’il semble faire, c’est mettre en concurrence ses enfants à la tête de diverses marques, pour probablement choisir ensuite son successeur. Et donc, ils se font la main. C’est ce qu’on observe au niveau du groupe. Mais quand on porte son regard sur les filiales, en particulier chez nous en Suisse, on subit. On a effectivement subi l’arrivée d’un jeune Arnault placé par son père chez Tag Heuer. Or, il a complètement échoué dans ce qu’il a entrepris. Dans l’horlogerie en Suisse, nous subissons un petit peu cette incapacité à redresser des marques ou à tester les générations suivantes. En revanche, il me semble que contrairement à Swatch Group, quand on connait un échec chez Tag Heuer, on change tout de suite le patron. Je ne dis pas non plus que Tag Heuer va mieux aujourd’hui, bien au contraire, mais ce n’est pas parce que c’est le fils Arnault qu’il va rester là pendant quinze ans en croyant qu’un jour, les choses iront mieux. Non, il a tout de suite été débarqué quand il s’est montré incapable de redresser la marque. Cette capacité à réagir est bien différente de ce que nous avons chez Swatch Group. J’ai un contre-exemple au modèle du CEO interne, c’est Audemars Piguet. Cette entreprise familiale fondée en 1875 ne connaissait pas la crise. Mais en 2012, elle a fait appel à un CEO externe, François-Henry Bennahmias qui s’est concentré sur un seul modèle, la Royal Oak qui réalise près de 90% des ventes (2023) et une stratégie de luxe exclusif avec réduction du nombre de boutiques et augmentation du prix des montres. Les propriétaires se sont rendu compte que ce CEO était meilleur que toutes les solutions que l’on pouvait trouver dans la famille. Car en définitive, c’est ce qui permet à des entreprises familiales de connaître la croissance dans l’horlogerie comme dans d’autres secteurs: le fait de reconnaître les capacités limitées au sein de la famille et d’appeler quelqu’un en dehors de ce cercle familial restreint. Cela démontre une sorte de froideur décisionnelle, mais aussi une lucidité stratégique sur le développement de l’entreprise.
Interview: François Othenin-Girard
Lire la suite page 19
Suite de la page 13